Analyse
Le cycle infernal : motif de la pourriture et de la décomposition
par Sandrine Meslet

Goutte d’eau qui tombe et se perd dans la mer,
Grain de poussière qui se fond dans la terre,
Que signifie notre passage en ce monde ?
Un vil insecte a paru puis disparu.
Omar Khayyam
A travers le naufrage d’un homme, Bandiougou, sous les yeux d’un groupe d’hommes attablés Chez Ngaoulo, l’étrange griot urbain Koulloun conte le destin d’un territoire et des hommes qui le peuplent. Ainsi s’ouvre le récit de Cousin Samba.
La dimension poétique du texte est assurée par l’abondance des métaphores, celles-ci illustrent la volonté de transfigurer par le biais de l’écriture poétique une situation politique critique. Monénembo revendique ainsi le choix de ne pas présenter son texte comme une simple diatribe anti-colonialiste, mais plutôt comme un brûlot critiquant la gestion des Indépendances. La transposition difforme et aliénée du réel suffit, elle présente un chaos auquel l’homme n’échappe pas et fait de son destin une spirale où seule la nature agit, engloutissant toute trace humaine.
La pourriture comme un rappel de l’état de nature
La citation en exergue d’Aimé Césaire revient sur le drame de l’attente « […] rien ne viendra et la saison est nulle », elle dit l’attente inutile ; le poète souffle à Tierno Monénembo une poétique de la désillusion et du non espoir. Le griot Koulloun lui-même avertit le lecteur dès le début, « N’en croyez rien si le cœur ne vous en dit. Je ne vous demande pas de croire[1] » sont les premiers mots du texte. L’auteur signale ainsi à son lecteur le caractère arbitraire de la vérité lorsqu’il est question d’écrire un roman. Même la description de Leydi-Bondi tend à s’annuler « rien ne mériterait d’être conservé : tout y pourrit avant même d’exister » ou bien plus loin « Ecoutez et oubliez. Ici le souvenir ne vaut pas un sou ». Le texte ne cesse de dire son insuffisance et décline, jusqu’à la rendre dérisoire, une parole confrontée à la multiplicité de l’expression « Je vous dirai…Je vous parlerai…Je vous conterai…J’évoquerai… ». La mort vient donner sens à l’insalubrité des lieux, à la malveillance des hommes. Le corps se décompose pour mieux rappeler la réalité physiologique du corps humain et Yabouleh, un des seuls personnages féminins du Leydi-Bondi, meurt d’un étrange mal, touchée par « le Mauvais-Liquide ».
La petite souffrit et se décharna sous nos yeux impuissants. Elle transpira. Elle eut froid. Elle claqua des dents. La diarrhée pressa son corps comme un citron et fit couler le long de ses cuisses d’abondants filets visqueux[2].
Les apparitions de grand-père Sibé viennent avertir le jeune Samba du danger qui le guette, la pourriture envahit alors le corps de l’ancêtre devenu charogne et reflète celle, invisible, qui atteint le jeune homme. En préparant le remède qui doit faire avorter Mme Tricochet de l’enfant qu’elle porte, Samba devient l’artisan de la mort de sa propre chair puisque que cet enfant est de lui. L’ancêtre apparaît mutilé par le manque de dignité de son petit-fils « En une bizarre attitude matérielle, Sibé tenait un enfant albinos hilare qui lui tétait la plaie[3]. » Le métissage, vu sous l’angle de la difformité, nourrit la dimension tragique d’un texte où tout semble concourir à la description de l’impuissance des hommes, à la banalité du mal.
L’expérience de la description
La trame du récit n’est pas la plus importante et la narration succombe aux détournements, ainsi les multiples digressions remettent la description au cœur du récit et présentent le texte comme un ensemble de tableaux vivants. On passe ainsi de la description du lieu où a grandi Cousin Samba, au récit de la guerre de Bombah illustré par l'emploi astucieux de la figure de l’hypallage. L'étopée du roi Fargnitéré, grand chef guerrier face aux armées des futurs colonisateurs, est ainsi révélée par l'intermédiaire de la description de son arme :
[…] mais l’arme s’était mise à évoluer toute seule, vibrant et miaulant à la fois, imitant le vagissement du bébé et les cris des bêtes de brousse, récitant des versets de prière, proférant des injures d’intraitable voyou, tour à tour hurlant et ricanant […] Elle empruntait le cri du hibou sous le nez de l’ennemi, hurlait dans les tympans de celui-ci la fureur discursive des bois sacrés […]Elle devenait tour à tour crinière de vieux lion, tête de chat sauvage, canari plein de tubercules aux allures de têtards qui braillent à qui mieux mieux. Elle rasait la plaine, tranchait l’herbe et confectionnait de gigantesques gerbes. Sa lame virait de l’argent à l’or, du cuivre à l’ivoire[4].
On note en effet que les caractéristiques de l’arme reprennent en fait celles du roi Fargnitéré, la description de l’arme permet de dresser le portrait du célèbre guerrier. En laissant la parole au grand-père Sibé pour relater le récit de la guerre de Bombah et décrire l’arme du roi Fargnitéré, le récit semble relancé par l’intermédiaire d’une parlure nouvelle qui vient enrichir le texte : « Parole de nos tonnerres en un jour sans pluie. Serment de nos baobabs dans l’intimité du roc ! Colère de nos dieux devant la luxure des hommes ![5] ». Ces phrases nominales, dans lesquelles l’absence de verbe accélère le rythme du récit, font basculer la phrase dans le domaine de l’incantation. La place de l’exemple au sein de cette délirante addition vient annuler ou du moins mettre en péril son effet, en le démultipliant à l’infini : « Une touffe d’herbe a défié l’harmattan. L’aveugle a provoqué la vipère. Voilà que le paralytique s’amuse avec la queue du lion. Qui ne connaît la panthère croit tripoter un chaton[6] ». Le récit de Sibé, empli de tradition épique, est cependant jugé ironiquement par les villageois qui s’interrogent sur sa prétendue présence sur les lieux du conflit. On passe ainsi d’une narration épique à son détournement parodique, une fois de plus le motif paraît être celui de la bascule. Tout et son contraire viennent dire la réversibilité du monde, son inconstance et son morcellement.
L’événement textuel : la mort
Le spectacle de la mort est décliné dans tout le texte, nous assistons à la tragédie qui suscite terreur et pitié aux yeux du griot Koulloun et de ses compagnons. L’ombre, qu’ils ont vu entrer dans le bar et dont ils semblent tout attendre, apparaît comme la métaphore de la mort. En effet, le personnage de Cousin Samba restera muet tout au long du roman, silencieux comme le surgissement de la mort qui frappe au hasard « [il] se mêla à notre existence jusqu’à en devenir une sorte de filigrane[7]. » C’est la voix de Bandiougou, compagnon d’infortune de Samba, que rapporte le griot Koulloun, il est celui qui sert de passeur entre son propre récit et celui de l’ombre, Samba. La léthargie dont sortent les personnages du bar Chez Ngaoulo, se fait par le surgissement d’un événement inattendu qui vient confondre leur quotidien. Pourtant le monde qu’ils découvrent, enivrant à souhait, n’en demeure pas moins une frontière entre le monde « du visible et de l’invisible ». L’expérience du récit se fait expérience de la mort, de sa propre disparition, dans le dernier chapitre du texte « Le commencement des choses » le griot urbain accompagne Samba à sa dernière demeure. La nature s’est emparée du village de Kolisoko, l’arbre se saisit de Samba en le réintégrant au cycle de la vie.
La voix de Wango, griot du roi Fargnitéré, surgit au moment du bannissement de Samba et de son grand-père Sibé pour leur porter réconfort « Ce n’est pas à toi qu’ils en veulent, Sibé. Ils en veulent à eux-mêmes, ils en veulent à leur oubli[8]. » Pourriture et décomposition viennent ainsi se mêler afin d’illustrer le manque de visibilité des hommes, qui refusent de voir le drame se jouer : « Un réveil terrible avait succédé à l’euphorie. La négraille désenchantée coulait un triste regard sur la nouvelle réalité et étouffait à tout bonheur son amertume[9]. »
[1] Tierno Monénembo, Les écailles du ciel, Seuil, coll. « Points », Paris, 1997 (1986 pour la première édition), p.13
[2] p.167
[3] p.121
[4] p.56-57
[5] p.54
[6] p.55
[7] p.27
[8] p.92
[9] p.151





 Visages de l’aube est une œuvre double dans laquelle le littéraire et le photographique se répondent, se nourrissent l’un l’autre, apparaissent comme deux versants de la même histoire : celle de l’arrivée à la vie. Visages de l’aube est une œuvre très peu connue qui gagne véritablement à être lue, et qui met en valeur l’importance et la richesse du premier regard des nouveaux-nés, à la fois dans le texte de Nancy Huston, les photos et le court texte de Valérie Winckler. À ce titre, il est significatif de voir comment notre regard se métamorphose, s’aiguise à la lecture des photographies, après la lecture du texte.
Visages de l’aube est une œuvre double dans laquelle le littéraire et le photographique se répondent, se nourrissent l’un l’autre, apparaissent comme deux versants de la même histoire : celle de l’arrivée à la vie. Visages de l’aube est une œuvre très peu connue qui gagne véritablement à être lue, et qui met en valeur l’importance et la richesse du premier regard des nouveaux-nés, à la fois dans le texte de Nancy Huston, les photos et le court texte de Valérie Winckler. À ce titre, il est significatif de voir comment notre regard se métamorphose, s’aiguise à la lecture des photographies, après la lecture du texte.  En 1996, Instruments des ténèbres
En 1996, Instruments des ténèbres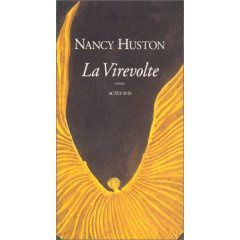
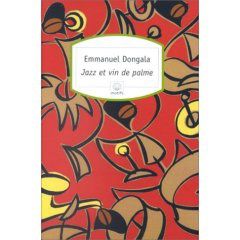 Musique et Liberté dans Jazz et vin de palme d’Emmanuel Dongala
Musique et Liberté dans Jazz et vin de palme d’Emmanuel Dongala 
 Adriana Mater ou le renouveau de la tragédie
Adriana Mater ou le renouveau de la tragédie