Afriquaparis reçoit Kossi Efoui
Soirée littéraire animée par Pénélope Dechaufour et Gangoueus
Morceaux choisis par Célia Sadai

Pénélope Dechaufour, Kossi Efoui et Gangoueus.
Pour sa dernière édition avant une pause ... d'un an!, Afriquaparis, la rencontre chic des cultures noires à Paris, reçoit le dramaturge et romancier Kossi Efoui, dont je parle beaucoup en ce moment sur le Blog.
Il faut dire que :
1. Kossi Efoui a publié en 2011 une pièce, Oublie! aux éditions Lansman, ainsi qu'un roman paru au Seuil, L'ombre des choses à venir. Il y a donc de quoi parler.
2. J'ai eu le plaisir de profiter, à l'occasion du dernier Festival d'Avignon, de flâneries et bavardages à durée indéterminée avec Kossi Efoui et Nicolas Saelens (compagnie Théâtre Inutile).
3. On peut voir Oublie! sur les planches, dans une mise en scène de Nicolas Saelens, au Théâtre de l'Etoile du Nord, depuis le mardi 29 novembre, jusqu'au samedi 3 décembre 2011.

Philippe Rodriguez-Jorda joue Enfant dans Oublie! de Kossi Efoui. Mise en scène de Nicolas Saelens, Compagnie Théâtre Inutile. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de la compagnie.
Ce soir sont présents Pénélope Dechaufour, doctorante en Théâtre et spécialiste de l'oeuvre de Kossi Efoui, et Gangoueus, blogueur ami de La Plume Francophone, qui va d'ailleurs recevoir ce samedi 3 décembre le Prix AMAKPA 2011.
Et moi, calée dans un fauteuil, je regarde Kossi Efoui plus à l'aise en Maître de Cérémonies qu'en auteur invité. Très taquin, il amuse le public et mène la danse avec les intervenants. En effet, pas facile de mener un entretien avec un auteur qui dans sa démarche d'écriture évacue le moindre contour d'une réponse! Kossi Efoui dit Non, soulève un paradoxe par ici, une aporie par là, et surtout expose ses raisonnements avec une maestria oratoire qui ne donne guère envie de poser la question suivante.
A ses côtés il y a son compagnon de route, le metteur en scène Nicolas Saelens, et tous deux m'évoquent un duo d'amis tels Pantagruel et Panurge, liés par un projet humaniste. Au fond de la salle sont sagement installés deux écrivains, Sami tchak et Kangni Alem. Un public de qualité, donc, pour une rencontre joyeuse, sans compter la présence de la compagnie du Théâtre Inutile, parmi lesquels les comédiens Angeline Bouille et Philippe Rodriguez-Jorda sont venus dire des extraits d'Oublie!
L'Ombre des choses à venir...
Gangoueus : L'Ombre des choses à venir fait le récit d'un déserteur, qui prend la parole depuis la cachette où il se terre au début du roman. Avec l'Orateur, il va raconter les raisons qui l'ont poussé à fuir le système d'un pays qu'on ne saurait identifier. D'où vous vient l'idée d'un roman sur la désertion?
Kossi Efoui: Le narrateur est un déserteur qui fuit une mission qu'il a refusée. La question que pose le roman, c'est : "Est-on prêt à payer pour sa liberté, est-on prêt à payer le prix de la solitude que cela demande?" Il y a un triangle formé par trois mots qui m'ont servi à écrire ce livre : le mot « vérité », le mot « liberté » et le mot « solitude » qui sont liés indissociablement quand je parle de "liberté". D'ailleurs il y a cette phrase d'Imre Kesrtész que je cite en ouverture au roman : « Le suicide qui me convient le mieux est manifestement la vie ». Le même Imre Kertész a dit « Qu'est-ce qu'être libre ? C'est avoir une pensée et être immédiatement prêt à se retrouver seul avec": alors, on est un esprit libre. Après tout, que nous apprennent Galilée, Giordano Bruno, qui étaient prêts à être seuls dans un contexte où, au nom d'une pensée dominante, on peut vous brûler, et ce n'est pas une image. C'est le lien entre "vérité", "solitude" et "liberté", c'est avec ce triangle là que ce garçon de 21 ans qui est le narrateur se regarde et regarde le monde.
Gangoueus : Le père de ce garçon a été déporté pendant plusieurs années dans un lieu qui s'appelle la Plantation, où l'on rééduque les personnes [NdA. Je vois la Plantation plutôt comme un camp de travaux forcés]. Le père a été amené là-bas pour une mission particulière.
Kossi Efoui : Non, c'est le fils qui se l'imagine ! Il faut dire qu'il a 21 ans, il se prépare à partir vers une destination étrange, l'île des hommes-crocodiles, et de façon définitive. Il va vers l'inconnu, ne sait pas ce qui l'attend, mais il sait qu'il n'y a pas de retour possible. C'est dans cette urgence que sa parole se déploie, on voit les étapes depuis la disparition de son père quand il était jeune enfant. On vivait alors dans le système de l'Annexion, donc on imagine bien un sytème d'oppression mais exercé par une force étrangère. Quand il a eu 9 ans, on a appelé cette époque tout à coup la Libération, qui serait venue mettre fin à la violence subie sous l'Annexion, et là tout va bien, on a découvert le pétrole... Ce qui est intéressant c'est que ce type de régime arbitraire nous pousse à nous poser la question : "Pourquoi l'a-t-on enlevé ?" Comme si l'on pouvait, en nous mettant un dossier sous le nez, nous expliquer comment et pourquoi on a pu faire ça. Donc, ne pas m'apesantir sur le pourquoi, c'est aussi une façon de désavouer ceux qui seraient prêts à m'expliquer qu'on puisse faire ça. Ainsi, je délégitime la question du pourquoi ?
Vous savez, je suis en train de lire le Journal d'Hélène Berr que je ne connaissais pas, cette jeune fille morte en déportation [NdA. Hélène Berra 21 ans lorsqu’elle commence à écrire son journal. En 1942, on proclame les lois anti-juives de Vichy, et sa vie bascule. Elle est morte en déportation à Bergen-Belsen, elle n’en reviendra jamais]. Elle raconte cette scène où l'on arrête le père, c'était un homme important, chef d'une entreprise, qui connaissait la police française. Un commissaire a appelé l'épouse pour lui dire ceci : « Vous savez Madame, avec la police française tout s'est bien passé, on l'aurait relâché si son étoile avait été bien cousue", parce qu'un officier allemand a remarqué que l'étoile n'était pas bien cousue et tout le problème est venu de là. Et le plus terrible, c'est que cette femme et sa fille protestent en disant – "Ce n'est pas vrai, c'est nous qui l'avons cousue". C'est-à-dire, en venir à dire qu'on a bien cousu l'étoile, c'est une abomination, comme si c'était justifiable d'une quelconque façon. Donc cet enlèvement sous l'Annexion reste injustifié, et scandaleux, puis à la Libération...
Gangoueus : C'est un peu absurde aussi puisqu'on l'enlève pour son talent de musicien...
Kossi Efoui : Il se trouve que le père est saxophoniste et dans cette Plantation où on l'emmène il y avait un orchestre, ce qui n'est pas nouveau : au Camp Boiro en Guinée [NdA. Camp d'internement militaire sous Sékou Touré], il y avait aussi un orchestre et dans plusieurs lieux au monde on a tout à coup voulu que les gens travaillent dans la gaieté ! Donc l'enfant va imaginer, plus tard, puisqu'il n'y a aucune explication, que c'est pour son talent de musicien qu'on a enlevé son père, parce qu'ils auraient eu besoin des services d'un saxophoniste ténor dans l'orchestre. Ce qui se passe réellement, c'est comment un enfant peut exorciser, par une force poétique, une blessure d'une rare violence.
KOSSI EFOUI LIT L'INCIPIT DE SON 4ème ROMAN, L'OMBRE DES CHOSES A VENIR

Gangoueus : J'ai une question cette fois liée à Solo d'un revenant ainsi qu'aux propos que vous avez tenus il y a deux ans lors des Rencontres d'Encre et d'Exil où vous exprimiez votre désir de ne pas être renvoyé à l'origine. Or, dans ces deux textes-là (et Solo d'un revenant), on voit d'abord quelqu'un qui veut revenir (Solo d'un revenant) puis quelqu'un qui souhaite partir (L'Ombre des choses à venir). Est-ce que finalement on ne revient pas toujours à un discours sur le Togo [NdA. pays d'origine de Kossi Efoui]?
Kossi Efoui : Dans Solo d'un revenant, ce que le personnage vient régler est au bout du compte une histoire intime. S'il n'avait pas eu un ami qui meurt en essayant de sauver des enfants, tandis qu'un autre prête son talent au tueur, il ne serait pas revenu là : pour quoi faire, pour contempler les ruines ? Ce qui le motive, ce n'est pas l'origine, pas le fait qu'il soit né là ! Ce qui le motive, c'est le fait qu'il a vécu quelque chose, il faut bien qu'il ait vécu quelque part ! Il se trouve que c'est là qu'il a vécu et pour régler cette contradiciton intime, il faut bien qu'il retourne là où ça s'est passé ! Le hasard a voulu que ce soit à l'endroit où il est né, mais ce n'est que le hasard ! C'est là où pour moi la chose devient intéressante... Si quelqu'un naît en Inde, ou au Sri lanka, mais qu'il vit quelque chose de semblable, l'expérience humaine étant au bout du compte une expérience du semblable, où que ça se déroule, quels que soient les détails extérieurs du contexte ou du décor historique, ce qui le motive, c'est cette part intime. Si je prends le cas de ce personnage-là, je peux imaginer qu'il rencontre un frère ou une sœur au Sri Lanka qui lui dise « Tiens, moi aussi j'ai vécu quelque chose de semblable ». Dans ce cas, si l'autre du Sri Lanka raconte ça, il va installer un décor avec ses images et souvenirs du Sri lanka, alors la question c'est le Sri Lanka ou le Togo ?
Kossi Efoui : Leçon sur l'arbitraire du signe
Pénélope Dechaufour : Kossi Efoui, romancier, est aussi l'auteur d'une quinzaine de pièces de théâtre. D'ailleurs, un ouvrage vient de paraître aux éditions L'Harmattan, qui publie les actes d'un colloque qui s'est tenu au Musée Dapper en février 2010 autour de l'oeuvre théâtrale de Kossi Efoui. L'ensemble des contributions propose un regard commun sur ce qui caractérise le théâtre de Kossi Efoui – qu'on ne saurait cerner par une définition car l'auteur a toujours emprunté la même posture intellectuelle : « ne pas se définir pour échapper à l'enfermement ». L'ouvrage décrit donc sa démarche d'écriture comme une interrogation sur la forme où les stratégies d'échappée et d'interrogation sont permanentes. Si l'enjeu thématique varie, il y a à chaque fois des personnages qui s'interrogent sur leur expérience humaine, la vie... Mais également sur la forme du théâtre. C'est sans doute ce qui amène le public à penser que le théâtre de Kossi Efoui est assez hermétique, car c'est une forme éclatée. J'aime comparer ses textes à un corps démembré, où les ficelles qui tiennent le tout ensemble auraient été gommées, de sorte qu'on ne saisit pas la représentation d'un « tout » qui avance et fait sens.
 Kossi Efoui, dans votre propre laboratoire d'écriture, qu'est-ce que le théâtre ouvre comme champ ? Est-ce que cette forme éclatée où « les fils conducteurs » ont disparu implique la participation active du lecteur? Cela est-il volontaire dans votre démarche d'écriture ? Je précise que ces questions me sont venues aussi en voyant le travail du Théâtre Inutile.
Kossi Efoui, dans votre propre laboratoire d'écriture, qu'est-ce que le théâtre ouvre comme champ ? Est-ce que cette forme éclatée où « les fils conducteurs » ont disparu implique la participation active du lecteur? Cela est-il volontaire dans votre démarche d'écriture ? Je précise que ces questions me sont venues aussi en voyant le travail du Théâtre Inutile.
Kossi Efoui : Je n'avais pas pensé à l'image des fils invisibles qui relient les parties. Je crois que Nicolas Saelens, qui est le metteur en scène de la compagnie Théâtre Inutile, aura des choses à ajouter à vos questions. Nicolas parle souvent de l'espace scénique comme d'un écran de projection, et les différents éléments qui rentrent en jeu dans l'écriture scénique contribuent aussi à construire cet écran de projection qu'est le spectacle, sont eux-mêmes autant d'écrans de projection. C'est ce que je fais avec les mots, c'est une façon pour moi de sortir de l'évidence des mots. Certains disent qu'on écrit parce qu'on est « amoureux des mots », moi ça n'a jamais été mon truc, c'est en méfiance totale envers les mots que j'écris, je me méfie au sens où j'ai l'impression que quand je parle je tire une corde dans ma direction, et chacun tire dans son sens. De l'autre côté, il y a aussi des gens qui tirent dans leur sens de sorte que quand j'arrive au mot, j'atteins une espèce de grand brouhaha avec plein de vendeurs de vérités.
J'ai passé une bonne partie de mon enfance dans une grande confiance familiale, pour moi, mon père et ma mère avaient raison, et leur parole était la seule vérité en dehors de laquelle il n'y avait pas de salut. Je trouve tout ça en vrac, et je me trouve parfois des maîtres à penser, des gourous qui me niquent au passage, et puis j'arrive à sortir de tout ça et je me dis, bon les mots sont à tout le monde, et moi aussi je vais agir dessus.
Donc à partir de ce moment, il y a tout un travail de dépollution, parfois même de sortir un mot de son contexte de sens : "et si ça ne voulait pas dire ça?", et d'arriver à la case vide, qu'il s'agit d'inventer avec du sens. Voici mon comportement quand j'écris. L'image de la case vide, cela renvoie à l'écran de projection. Si je propose des images que je construis avec des mots, c'est pour arriver à ce geste du conteur qui dit - ce clin d'oeil du conteur qui dit « Vous avez vu ce que j'ai vu ? ». Ce n'est pas pour montrer, c'est plutôt comme on soulève « Vous avez vu ce que j'ai vu ? ». Il y a plein de touchers du mot comme cela, comme si c'était de la matière concrète, avec toutes sortes d'outils comme un artisan qui va utiliser une brosse parce que c'est délicat, un petit marteau au lieu d'un grand marteau... C'est tout ce travail du texte, c'est ce travail là qui explique pourquoi on dit que je suis un dramaturge qui écrit des romans : parce que je pars du principe que, que ce soit roman ou théâtre, j'ai le même comportement avec les mots, je cherche à les détourner, à voir jusqu'à quel point le mot a fini de mentir. C'est ce rapport-là au mot, qu'on va réduire en unités simples, quand il se présente parfois sous forme de formule comme on dit par exemple « On a tout dit quand on a dit ça ». Voilà, on n'a pas tout dit quand on a dit ça, il faut regarder dedans, car on n'a pas tout dit. Si moi je commence à écrire avec le sentiment qu'on a tout dit, à partir de là en revanche commence le travail, sinon c'est faire mentir que de dire cette formule. Donc le clin d'oeil renvoie à nouveau à l'écran de projection. Il s'agit de réduire des formules massives à leurs unités simples. Par exemple, le mot race, on entend "Mais enfin, c'est évident quand même que les races existent !! Vous voyez qu'il y a des blancs, des noirs, des jaunes !" Faire des hérarchies entre les races est impertinent pour tous, mais qu'on fasse le constat de l'existence des races, cela parait évident comme si depuis que l'homme existe, les hommes avaient perçu l'humanité en ethno-types. Or, cela ne s'est constitué qu'au 19ème siècle, pourtant le mot "race" apparaît comme porteur d'un sens de tout temps et on rencontre des gens qui s'étonnent face à la question "Finalement est-ce que la question n'est pas l'inadéquation d'un mot ?","Est-ce que la question n'est pas que l'on est dans une culture hi-tech du 21 ème siècle avec une perception des êtres humains basée sur une biologie du 19ème siècle ?" Et quand on questionne la chose comme ça on peut se dire : à la limite si l'on a pas d'autre mot, "foutons-nous du mot race puisque c'est complètement inopérant"! Mais non, on repart là-dedans parce que le mot pèse encore de tout son poids, une gigantesque architecture, mais c'est un mot, alors comment réduire tout l'édifice à ses unités simples et à partir de là, commencer à dire quelque chose, à raconter quelque chose?
Pénélope Dechaufour : On devine dans vos propos l'importance que vous accordez à la parole et au matériau des mots, comme à la représentation théâtrale. Du coup, Nicolas Saelens et vous vous rejoignez sur la question du corps-texte, ou du texte comme un matériau, mais aussi sur le fait que Théâtre Inutile est une compagnie qui travaille beaucoup la marionnette et qui a une démarche "artisanale" dans la création théâtrale. Je pense que la démarche de Kossi Efoui dans le traitement du mot a besoin d'être nourrie aussi de la représentation et de tout ce qui est convocable pour nourrir un spectacle; d'où pour moi la relation de compagnonnage qui lie Kossi Efoui au Théâtre Inutile depuis maintenant 2006. Je voulais qu'on revienne sur cette relation en écoutant Nicolas Saelens.
Nicolas Saelens: A quoi faites-vous référence quand vous parlez d'"artisanat"?
Pénélope Dechaufour : Eh bien, pour reprendre les mots de Kossi, c'est le côté "faire du théâtre avec 3 bouts de ficelles" et réussir à faire advenir une multitude de langages. Je voulais vous interroger sur ce que vous deux nommez la « co-inspiration », pour moi, c'est tout ça qui fait sens.
Nicolas Saelens : Le processus d'écriture et de travail du texte de la pièce Oublie ! a été de se réunir ensemble autour d'un conte, que tu as ramené, Kossi, et de le mettre en voix, jouer avec. Puis, à partir de cela, on a fait rentrer les « éléments » qui vont constituer le spectacle, en faisant appel au plasticien Norbert Choquet, et à Karine Dumont pour composer la musique. Tout est entré en jeu pour se mettre en place en terme d'écriture, donc Kossi a procédé au travail au plateau (sur scène) durant une dizaine de jours avec Angeline et Philippe; chacun s'inspirant de ce qui s'est fabriqué dans les mises en jeu. De là sont nés les personnages d'Enfant et de la Sauvage. Au fur et à mesure, les scènes et la dramaturgie se sont plantées. Au terme de 6 mois, le texte était posé. Chaque élément rentrait dans l'articulation du sens et des espaces qui avaient été créés. On a cherché à faire un tissage des éléments pour faire sens tout en laissant de l'espace de projection pour le spectateur. On a donc exploité le pouvoir de suggestion de la marionnette, au point de manipuler de l'informe (comme l'ectoplasme à l'ouverture de la pièce). De là, on invite les spectateurs à projeter sur cette forme, et c'est en cela que je trouve que l'écriture de Kossi est un outil formidable, car elle permet de donner des espaces, d'inviter les spectateurs à projeter des choses à l'intérieur. Pour moi c'est une articulation qui permet de ne pas fermer la multitude des sens. Pour Kossi, le mot "Oublie" ou "Concessions", comme le mot "Inutile" pour la compagnie, est à prendre avec des sens multiples : on peut pénétrer le mot par plusieurs endroits. Et quand Kossi pose un mot, c'est pour sa multitude de sens.
Penda Traoré : Dites-moi ce qu'il faut savoir quand on ne connaît pas la pièce Oublie!, ni la compagnie du Théâtre Inutile, ni l'écriture de Kossi Efoui?
Kossi Efoui : La première chose à savoir : j'ai pensé dès le départ à Oublie! comme un spectacle adressé à un jeune public : moi dont on dit beaucoup que mon écriture est hermétique, certains se sont inquiétés quant à ce que j'allais proposer aux enfants! Disons que c'est une "pièce de théâtre hermétique pour enfants". Au départ c'est un conte traditionnel qu'on m'a raconté un jour et qui tient sur 3 lignes. "Un jour on a dit que l'esprit des choses s'étant fait homme, se mit à parler une langue étrange, alors dans le village on a paniqué, on attrapé le parleur de langue étrange et on l'a jeté à l'eau. Mais un pécheur pêche un poisson et se met à parler lui aussi une langue étrange. On l'enterre dans le désert et quelques poussières de sable vont tomber dans le couscous d'un chasseur, qui se mit aussitôt à parler une langue étrange : on l'a envoyé dans l'espace. Un jour, un quatrième personnage qui jouait d'un instrument avec accords et harmonies célestes respire l'air des hauteurs et un parfum venu de l'espace lui pénètre les narines. Et aussitôt il se met à chanter ces paroles étranges et alors le conte dit qu'on laissa vivre pour la première fois un homme à la parole tordue, à la parole étrange." On n'est pas loin du lien que je faisais au sujet de L'Ombre des choses à venir, sur ce triangle "vérité-solitude-liberté". C'est dire aussi que toutes les grandes questions philosophiques, on se les pose enfant, même sans outil de formulation et d'analyse, mais ces questions sont valables dans la tête d'un enfant comme dans celle de Socrate. Donc il faut trouver un moyen de partager en égalité d'esprit des questions qui persistent tout au long d'une vie. Je trouve aussi important d'avertir les enfants très tôt du caractère précieux de leur liberté et sur les prédateurs qui sont à l'affût de cette liberté, prêts à la mettre en cage : "Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Tu dis que tu m'aimes et j'ai peur."
LA COMPAGNIE THEATRE INUTILE DIT DEUX EXTRAITS DE OUBLIE!
par Angeline Bouille et Philippe Rodriguez-Jorda
Oublie! suivie de Voisins Anonymes (ballade), Carnières, Lansman, 2011.

Questions du public
Question du public : J'ai assisté à la représentation de Oublie! au Festival d'Avignon l'été dernier. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de sens et ce n'est pas un spectacle qui s'adresse uniquement à des enfants; si l'on peut vraiment dissocier les deux publics. Comment avez-vous procédé dans la mise en scène pour restituer les différents effets de sens ?
Nicolas Saelens: Il n'y a effectivement pas de frontière entre théâtre pour enfants et théâtre pour adultes. Les enfants font leur propre chemin dans le spectacle, et procèdent par choix. Nous avons néanmoins collaboré avec une enseignante qui a accompagné le projet en concevant un dossier pédagogique. A propos du dispositif scénique, nous avons travaillé à partir de l'obscurité. On ne voit pas les déplacements, il y a surtout un jeu d'apparition/disparition de la Sauvage auprès d'Enfant, ce qui est propice à la projection. Dans ce plan noir, le costume d'enfant est blanc, dans une matière de bâche de sorte qu'il apparaît d'abord comme un ectoplasme puis comme un cocon, enfin tout cela se développe au fur et à mesure pour aller vers la case vide, où il va se réaliser, se trouver. Mais la pièce ne nous y amène pas ! C'est son parcours dans le monde des histoires où il doit se dégager des impasses qui viennent sur son chemin, et comment à chaque fois la Sauvage apparaît pour l'emmener ailleurs, c'est cela qui est au coeur de la pièce.
Gangoueus : J'ai une question qui rejoint celle de l'origine, une thématique chère à mes yeux : quel regard portez-vous à la littérature togolaise ?
Kossi Efoui: Je ne connais pas, je ne sais pas... bien sûr je connais Sami Tchak, d'ailleurs c'est très bien qu'il soit là ce soir, pour parler de la littérature togolaise ! En effet, la première fois que j'ai rencontré Sami Tchak, c'était à un salon du livre à Toulouse il y a dix ans. Je lui ai tapé sur l'épaule et il m'a dit "Moi je me sentirais plus proche de Paul Morand que de Kossi Efoui par exemple, en termes littéraires". Voilà, allez trouver de la littérature togolaise là-dedans, la réponse est à cet endroit là. Kangni Alem, je le lis depuis la fac, mais dans mes croisements je le rapproche d'un Russe, d'un Italien. Sami Tchak, c'est Paul Moran ou un Tchèque.
Astou Camara-Arnould : Je voulais revenir sur votre travail de déconstruction des mots qui, selon l'instant et la réalité perçue, sont détruits dans leur valeur de vérité absolue. Vous encouragez le lecteur à agir avec vigilance : quels mots doit-on prononcer ? Par quels détours, quelles ruses, peut-on alors communiquer ?
Une jeune femme intervient pour demander de l'aide à Kossi Efoui car elle n'a jamais réussi à lire son premier roman La Polka, malgré plusieurs tentatives.
Kossi Efoui : C'est le destin d'un livre de tomber des mains du lecteur, il n'y a alors aucun événement. Or, comment se fait-il qu'un livre nous tombe des mains, mais qu'on ne l'oublie pas? Des années après on le retrouve et l'on se demande comment on a pu passer à côté de ça. Qu'est-ce que cette expérience? Là il y a un événement, ça fait signe, je me dis « à nous deux, on verra bien ». Entre mon dernier roman, L'Ombre des choses à venir et La Polka[NdA. premier roman, 1998], on me dit qu'il y aurait moins de chausse-trappes, de pièges pour le lecteur. Je pense à regret que l'on n'a plus, en tant que lecteur ou dans notre formation, de place pour l'abandon. Parfois on est face à certains textes ou spectacles comme dans un combat pied à pied, c'est dans le je ne sais pas aussi que l'on capte quelque chose d'un texte, que je vois jusqu'à quel point je peux m'abandonner : mais cela demande une confiance... "S'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de communication" disait ce prof de philo qui entre dans sa salle de classe et qui voit que les étudiants ne remarquent pas sa présence : "puis je suis sorti et rien n'a changé, alors j'ai pris le plus gros livre sur la table et j'ai tapé sur la table". Cela a créé un événement, quelques secondes de silence puis il a dit "Surtout, faites comme si j'étais là". Ce n'est pas la communication qui va faire la communion. Il faut que je m'abandonne à quelque chose, que je prenne un minimum de risques et peut-être que pendant ma lecture je vais être transformé, passer par des états où je ne passe pas d'habitude puisque l'auteur écrit aussi un peu ce qu'il vit. L'auteur n'est pas là pour parler de ses états habituels, de ses croyances habituelles, ou servir une idéologie, même noble, et les valeurs qu'on voudrait voir triompher dans la société : alors, on s'ennuyerait. C'est parce que lui-même est traversé d'états inhabituels qu'arrive l'inédit, et le lecteur est invité à cet abandon, à ce jeu avec l'inhabituel ; mais c'est de moins en moins ce qu'on transmet dans l'apprentissage de la lecture, et ça se sent par le fait que l'on a abandonné l'usage d'apprendre par cœur des poèmes et à les réciter avec plaisir, indépendamment de l'analyse. Le poème est comme une musique.
AFRIQUAPARIS est une initiative culturelle mise en place à paris par Penda Traoré et Astou Camara-Arnould. Pour en savoir plus : http://afriquaparis.blogspot.com/
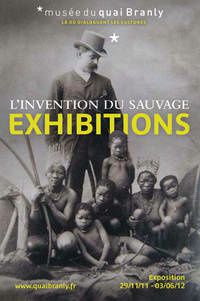




 Habel est le premier roman de Mohammed Dib sur le thème de l’exil. Il sera suivi par Les Terrasses d’Orsol. Entre les deux, il a publié des contes, des nouvelles et des poésies. Les Terrasses d’Orsol s’ouvre sur cette phrase : « Je suis revenu. » Rattachée à la suite du texte, elle prend un sens précis. Mais prise à elle seule, il nous semble qu'elle veut annoncer le retour de Dib au roman comme un retour volontaire. « Je suis revenu »veut dire qu’il y a déjà eu un travail entamé et qui n’a pas abouti. L’auteur revient pour le mener à bout. Le style de l’écriture n’a pas changé. Fragmentés, pour ne pas dire étoilés, les deux romans sont marqués par la folie. Le narrateur/acteur est en quête de quelque chose qu’il n’arrive pas à toucher.
Habel est le premier roman de Mohammed Dib sur le thème de l’exil. Il sera suivi par Les Terrasses d’Orsol. Entre les deux, il a publié des contes, des nouvelles et des poésies. Les Terrasses d’Orsol s’ouvre sur cette phrase : « Je suis revenu. » Rattachée à la suite du texte, elle prend un sens précis. Mais prise à elle seule, il nous semble qu'elle veut annoncer le retour de Dib au roman comme un retour volontaire. « Je suis revenu »veut dire qu’il y a déjà eu un travail entamé et qui n’a pas abouti. L’auteur revient pour le mener à bout. Le style de l’écriture n’a pas changé. Fragmentés, pour ne pas dire étoilés, les deux romans sont marqués par la folie. Le narrateur/acteur est en quête de quelque chose qu’il n’arrive pas à toucher. 
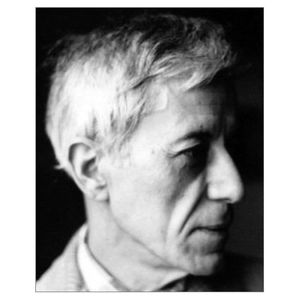 Mohamed Dib, né à Tlemecen en Algérie en 1920, est romancier et nouvelliste. Il est également l'auteur de pièces de théâtre et de contes pour enfants.
Mohamed Dib, né à Tlemecen en Algérie en 1920, est romancier et nouvelliste. Il est également l'auteur de pièces de théâtre et de contes pour enfants. 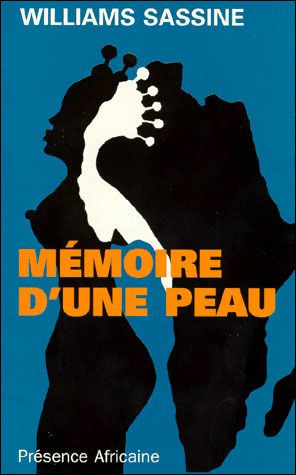



 Kossi Efoui, dans votre propre laboratoire d'écriture, qu'est-ce que le théâtre ouvre comme champ ? Est-ce que cette forme éclatée où « les fils conducteurs » ont disparu implique la participation active du lecteur? Cela est-il volontaire dans votre démarche d'écriture ?
Kossi Efoui, dans votre propre laboratoire d'écriture, qu'est-ce que le théâtre ouvre comme champ ? Est-ce que cette forme éclatée où « les fils conducteurs » ont disparu implique la participation active du lecteur? Cela est-il volontaire dans votre démarche d'écriture ?







