« Ma confiance dans la poésie est sans limite[1] »
Par Virginie Brinker
12 janvier 2010, 16h53. « Tout bouge autour de Dany Laferrière[2] », alors qu’il attend au restaurant de l’hôtel Karibe, avec son ami éditeur Rodney Saint-Eloi, les plats de homard et de poisson gros sel qu’ils ont commandés. L’auteur haïtien, venu de Montréal pour un festival littéraire organisé à Port-au-Prince, est piégé par le séisme.
Un témoignage de l’entre-deux
Il est tout à fait frappant de noter que Tout bouge autour de moi prend parfois l’allure d’une description clinique où l’absence de subordination, de coordination, l’usage de modalisateurs comme « paraît-il[3] », et de la focalisation externe (comme dans « L’échelle »), sont autant de procédés qui exhibent l’extériorité de l’événement, même si le témoignage est également emprunt de subjectivité, d’intériorité et même d’intimité, lorsqu’il est par exemple question de la mère de l’auteur. Récit et discours s’entremêlent également, la narration étant parfois émaillée d’aphorismes, de méditations –
L’ennemi n’est pas le temps mais toutes ces choses qu’on a accumulées au fil des jours. Dès qu’on ramasse une chose on ne peut plus s’arrêter. Car chaque nouvelle chose appelle une autre. C’est la cohérence d’une vie. On retrouvera des corps près de la porte. Une valise à côté d’eux[4].
– qui rendent d’autant plus cinglants le récit et le témoignage et en renforcent la puissance d’évocation.
Celle-ci est d’ailleurs au cœur des préoccupations du scripteur dont l’écriture cherche parfois à rivaliser avec l’efficacité et le pouvoir de l’image, comme dans le passage qui narre la rencontre avec le photographe amateur de Miami, où les deux arts sont nettement mis en concurrence :
Pourquoi ne prend-on pas le temps de regarder au moins celui qu’on photographie ? D’où vient ce goût de mitrailler ainsi les gens ? (…) Cela me prend au moins une heure pour croquer une scène alors qu’avec son appareil photo il peut en faire une cinquantaine en une minute. J’ai l’air d’un vieil artisan avec mon carnet noir où je note le moindre détail qui me permettra de dessiner un visage[5].
L’image, permet en effet de capter un instant et de le figer dans l’éternité, comme cette photo de Demers du « jeune garçon au regard si doux qui restera[6] », avec une facilité parfois déconcertante. Par ailleurs, les icônes télévisuelles consacrées par les différentes chaînes internationales, telles ce jeune homme au visage lumineux sortant d’un trou, ont un redoutable pouvoir, celui de forger une mémoire de toutes pièces, tout en en dépossédant les individus : « Je sens qu’on est en train de nous confectionner une mémoire[7] ». D’où la volonté de l’auteur de s’éloigner à la fin du livre de la « rumeur intoxicante » en partie assimilable au brouhaha médiatique, afin de préserver les « images qui brûlent encore en [lui] », comme la petite fille soucieuse de savoir s’il y aurait classe le lendemain, ou celle de la marchande de mangues. Mais toujours est-il que cette réflexion sur le pouvoir informant et déformant de l’image ne peut s’empêcher de rejaillir sur la possibilité de la mise en mots elle-même.
Dire le séisme
« Il s’était passé quelque chose d’une ampleur inimaginable », peut-on lire à la page 27 alors qu’un des fragments qui compose l’œuvre est intitulé « Ça[8] »… Difficile de mettre des mots sur le séisme qui a secoué Haïti ce jour-là. La mémoire du scripteur bute d’ailleurs sur l’événement, comme en témoigne la reprise entêtée de la mention de l’horaire, « 16h53 », aux pages 19, 22, 37, 39 par exemple, – comme pour mieux dire « le moment fatal qui a coupé le temps haïtien en deux[9] » – ou encore la répétition de l’épisode inaugural de la commande au restaurant 41 pages après l’incipit.
Pourtant la parole est urgente. Elle est produit de première nécessité dans le monde de l’après-séisme où le silence se fait menace : « Chacun est muré dans son drame personnel. Le langage se résume alors à l’essentiel[10] ». Elle est aussi prévention, précaution, anticipation nécessaires, avant que les mots d’autres ne s’emparent de la mémoire de l’événement et consacrent la malédiction d’Haïti ; « avant qu’on se mette à parler de vaudou, de sauvagerie, de cannibalisme, de peuple de buveurs de sang, je me sens encore assez d’énergie pour contrer ça[11] ».
Le besoin impérieux de mise en mots se fait ainsi dans l’œuvre de façon particulière, notamment via l’usage des métaphores, notamment celles qui se fondent sur le recours aux quatre éléments. La métaphore de l’eau, en particulier celles de la mer et de la tempête, est ainsi parfois utilisée pour dire le séisme : « la pièce s’est mise à tanguer[12] », « notre petit groupe donne l’impression d’être échoué sur une île déserte au lendemain d’une grosse tempête en mer[13] ». On trouve aussi celles de l’air – « Certains voient s’envoler, en une minute, le travail d’une vie. Ce nuage dans le ciel tout à l’heure c’était la poussière de leurs rêves[14] » – ou encore du feu, Port-au-Prince étant qualifiée de « chaudière[15] ». Mais lorsqu’il s’agit de parler de la terre, plus de métaphore, plus de détour ni de déguisement, l’expression se découvre dans toute sa nudité : « la terre vient de bouger »… comme si l’ « on p[ouvai]t se cacher du vent ou même du feu, mais pas d’un sol qui s’agite[16] ».
Par ailleurs, l’usage très particulier des personnifications est aussi un moyen de dire, de manière oblique, le séisme. Les objets sont dotés de vie, pour mieux souligner la violence des secousses : les « immeubles s’agenouill[ent] [17]», « tien[nent] à peine sur [leurs] jambes[18] », « dans les chambres d’hôtel souvent exiguës, l’ennemi c’est le téléviseur. On se met toujours en face de lui. Il a foncé droit sur nous[19] »… Alors que les humains sont parfois réifiés, pour mieux souligner le contraste, comme ce bébé qui le « dévore de ses yeux noirs de souris effrayée[20] », ou encore lorsqu’« à chaque nouvelle secousse, si minuscule soit-elle, on voit les têtes de ceux qui sommeillaient se relever comme des lézards aux aguets[21] ». Sans compter les « cris » qui viennent parfois déchirer les pages. Les métaphores ou comparaisons fictionnelles sont aussi un moyen d’évoquer l’événement : « je pensais aux films catastrophe, me demandant si la terre allait s’ouvrir et nous engloutir tous[22] », « on se relève lentement, comme des zombis dans un film de série B[23] ». Elles apparaissent toutefois comme quelque peu stéréotypées, comme pour suggérer que l’imagination peut être paradoxalement la seule médiation possible de l’inimaginable, tout en en soulignant la fatale insuffisance. Quelle peut être dès lors la part et la nature de l’œuvre d’art qui dit le séisme ?
« Tout fini[t] en Haïti par un recueil de poèmes[24] »
En se promenant dans le jardin, après le tremblement de terre, l’auteur est surpris de constater que les fleurs se balancent encore au bout des tiges… « Le béton est tombé. La fleur a survécu[25] », de même que la possibilité d’une œuvre monumentale classique s’est écroulée, et qu’il ne reste de l’expression que sa fine fleur, sa poésie.
Dans une discussion aux dimensions métatextuelles avec son neveu qui souhaite écrire un roman sur le drame et lui demande de lui céder la prérogative, l’auteur note :
De toute façon, un pareil roman n’est pas dans mes cordes (…). Ce grand roman d’écriture classique qui se passe en un lieu (Haïti) en un temps (16h53) et qui met en scène plus de deux millions de personnages. Il faudra un Tolstoï pour tenter un tel pari[26].
Tout bouge autour de moi n’est pas ce roman, se refuse de l’être, se donne à lire autrement, comme une gigantesque forme-sens dont les fragments coupent le fil du récit pour mieux rappeler peut-être la difficile communication après le séisme : « Tous les fils qui nous reliaient les uns aux autres étaient maintenant coupés[27] ».
L’œuvre ainsi passée, comme Haïti, au « shaker[28] », seule la poésie reste. Indissociable du souci constant des images et du rythme de l’écriture :
La radio annonce que le Palais national est cassé. Le bureau des taxes et contributions, détruit. Le palais de justice, détruit. Les magasins, par terre. Le système de communication, détruit. La cathédrale, détruite. Les prisonniers, dehors. Pendant une nuit, ce fut la révolution[29].
Mais la poésie de Dany Laferrière apparaît avant tout comme un art de la nomination. Sur les 128 fragments que comptent le texte, 84 commencent par les articles définis « le », « la », « les ». Nommer, voilà ce qu’il reste à faire, ce qu’il faut faire car « on est encore un zombi tant que personne n’a crié notre nom[30] ». Nommer c’est rappeler à la vie, accepter le face à face qui permettra, un jour, peut-être, de vivre autrement. « Nous devons affronter “la chose”, comme on l’appelle déjà dans les quartiers populaires. Il nous faut le nommer si nous voulons le digérer[31] ».
[1] Dany Laferrière, Tout bouge autour de moi, Grasset, 2011.
[2] Comme l’écrit Alain Mabanckou : http://blackbazar.blogspot.com/2011/02/tout-bouge-autour-de-dany-laferriere.html
[3] Employé par exemple à la page 55. Dany Laferrière, Tout bouge autour de moi, op. cit.
[4] Fragment intitulé « Les Choses », cité in extenso, ibid., p. 19.
[5] Ibid, p. 120.
[6] Ibid, p. 60.
[7] Ibid., p. 87.
[8] Ibid., p. 39.
[9] Ibid., p. 22.
[10] Ibid., p. 20.
[11] Ibid., p. 79.
[12] Ibid., p. 16.
[13] Ibid., p. 31.
[14] Ibid., p. 18.
[15] Ibid., p. 31.
[16] Ibid., p. 28.
[17] Ibid., p. 12.
[18] Ibid., p. 15.
[19] Ibid., p. 14.
[20] Ibid., p. 16.
[21] Ibid., p. 28.
[22] Ibid., p. 14.
[23] Ibid., p. 15.
[24] Citation de Paul Morand dans son essai Hiver caraïbe, cité p. 13.
[25] Ibid., p. 21.
[26] Ibid., p. 51-52.
[27] Ibid., p. 22.
[28] Ibid., p. 70.
[29] Ibid., p. 29.
[30] Ibid., p.38.
[31] Ibid., p.47.








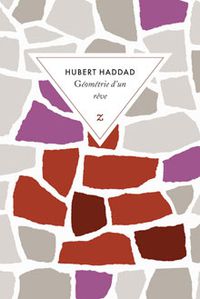



 Le Clan Boboto est le second roman du franco-congolais
Le Clan Boboto est le second roman du franco-congolais