Présentation
Sur les cimes de l’amitié
par Ali Chibani
 D’une amitié. « Correspondance. Jean Amrouche-Jules Roy (1937-1962) »[1] a été publié à l’occasion de l’exposition et du colloque international organisés, en 1985, par les Archives de la Ville de Marseille en hommage au père fondateur de la littérature francophone algérienne, Jean Amrouche. Cet ouvrage, exceptionnel par l’intensité des sentiments qui s’en dégagent, par la profondeur du raisonnement et par la grandeur du style déployées par les deux correspondants, rassemble des documents allant essentiellement de 1937, année où Jules Roy et Jean Amrouche se sont connus à Paris par l’entremise du poète Armand Guibert, à la mort prématurée de l’auteur de L’Éternel Jugurtha le 16 avril 1962. D’une amitié est surtout composé de lettres échangées par Jean Amrouche et Jules Roy. On trouve aussi d’autres documents tels que des articles des deux poètes ou encore des lettres écrites par des amis de Jean Amrouche, ainsi que par sa femme Suzanne dont la dernière est datée de 1983.
D’une amitié. « Correspondance. Jean Amrouche-Jules Roy (1937-1962) »[1] a été publié à l’occasion de l’exposition et du colloque international organisés, en 1985, par les Archives de la Ville de Marseille en hommage au père fondateur de la littérature francophone algérienne, Jean Amrouche. Cet ouvrage, exceptionnel par l’intensité des sentiments qui s’en dégagent, par la profondeur du raisonnement et par la grandeur du style déployées par les deux correspondants, rassemble des documents allant essentiellement de 1937, année où Jules Roy et Jean Amrouche se sont connus à Paris par l’entremise du poète Armand Guibert, à la mort prématurée de l’auteur de L’Éternel Jugurtha le 16 avril 1962. D’une amitié est surtout composé de lettres échangées par Jean Amrouche et Jules Roy. On trouve aussi d’autres documents tels que des articles des deux poètes ou encore des lettres écrites par des amis de Jean Amrouche, ainsi que par sa femme Suzanne dont la dernière est datée de 1983.
La littérature au cœur de l’amitié
La correspondance de Jean Amrouche avec Jules Roy se caractérise par la grande sincérité des deux auteurs qui s’admirent et s’aiment mutuellement. Pour eux, les lettres tinrent lieu d’espace de discussion pour dépasser l’impossibilité de se rencontrer. Jean Amrouche commente ainsi ce qu’il vient d’écrire dans son courrier du 12 février 1945 : « Je m’interroge avant d’envoyer cette lettre : elle sonne faux, car j’ai élevé la voix alors que j’aurais dû te parler à voix basse[2]. » Des brouilles, il y en eut aussi et elles furent réglées avec une honnêteté parfois si brutale qu’on pourrait s’étonner que l’amitié des deux personnalités ait résisté à tant d’orages. Ces lettres montrent la grande confiance que Jules Roy a mise en Jean Amrouche et l’estime portée par celui-ci à celui-là. En tout cas, elles donnèrent lieu à des réactions où la poésie de l’expérience ne contrarie point la poésie des sentiments. Amrouche a servi de grand frère qui console et encourage dans les moments difficiles l’aviateur engagé dans la Seconde Guerre mondiale à qui il prodiguait aussi ses conseils littéraires :
Que ta méditation se poursuive dans le concret, et notamment dans le drame, très bien. Encore faut-il que les grands mouvements en soient clairs. Ton livre [Le Métier des armes] doit être entièrement construit selon le rythme d’une prise de conscience, qui aboutit au renoncement. Dans le détail de l’écriture, il y a de belles choses (mais qui ne diffèrent pas assez de la Vallée [Heureuse] – surtout le début), mais aussi des choses détestables. Tes analyses tournent court. Parfois on a le sentiment que tu n’as pas eu le courage et la patience d’aller au fond des problèmes[3].
Jean Amrouche a été le premier lecteur des ouvrages de Jules Roy qu’il commentait sans complaisance.
Le poète kabyle a été très affecté par son impuissance à écrire le roman dont il a toujours rêvé (La Mort d’Akhli) et à mener à bout ses projets d’écrivain.Nombreuses sont les lettres où il s’en ouvre à Jules Roy : « Je rêve, naturellement : J’imagine que cette année je parviendrai à déblayer une partie de ma route : finir Jugurtha, mettre au point “Mesures pour Rien”, avancer mon livre sur la France et dicter la première version de La mort d’Akhli[4]. » De son côté, Jules Roy a compris la détresse d’Amrouche : « Tu dois faire passer, insiste-t-il, avant tout, p.c.q. [parce que] cela prime tout, l’effort consacré à ton roman. Il faut te retrancher du monde, il faut te tirer de l’infernal filet de ta vie, il faut te garder de la pitié, de l’amour fraternel et sauver chez toi le meilleur[5]. » L’explication donnée par Amrouche à cette impuissance dépend des conjonctures. S’il est des moments où il parle de sécheresse, il souligne à maintes reprises son engagement total dans la vie de la revue Tunisie Française Littéraire (T.F.L.), dont Armand Guibert lui confia les rênes, et de la revue Arche, parrainée par André Gide. Amrouche, comme Roy dans ses débuts, devait produire une profusion d’articles pour répondre à ses besoins pécuniaires. En effet, l’auteur de Cendre et d’Étoile Secrète avoue avoir voulu intégrer la petite bourgeoisie afin de se garantir une certaine autonomie financière qui lui aurait permis de se consacrer à ses activités littéraires : « Peu à peu, cependant, j’ai senti le poids des ans. L’alibi majeur c’était la nécessité de vivre, de construire, à partir de rien, une petite aisance bourgeoise qui assurait au mieux une relative sécurité. Mais que suis-je devenu dans tout cela ? Quelqu’un qui ne disait jamais je, qui parlait toujours au nom d’autrui, et qui gardait pour lui un secret étouffant[6]. » Les frustrations de Jean Amrouche, qui demandait par moments à son ami « Julius » de lui acquérir des costumes et des pantalons, étaient accentuées par sa fréquentation des grands cercles littéraires algérois et parisiens : Albert Camus, André Gide, Armand Guibert, Henry de Montherlant, Jean Paulhan…
Face à un Jules Roy qui produisait avec aisance car il avait emmagasiné suffisamment d’histoires dans les guerres qu’il avait faites, Amrouche s’accrochait à des projets alternatifs. Il comptait ainsi rassembler l’ensemble de sa production (poésie, essai, traductions…) dans un seul ouvrage. Grâce à ses lettres, on comprend que Jean Amrouche était moins attaché à Cendre qu’à Étoile Secrète. Mais l’ouvrage dont il éprouve la plus grande satisfaction – sentiment partagé par son ami Roy – est Chants Berbères de Kabylie publié en 1939.
« Frères de sang »
La littérature ne fut pas la seule préoccupation des deux hommes. Elle était même un moyen de mieux s’engager dans l’Histoire et de s’en guérir. Jules Roy avait intégré l’aviation militaire des alliés pendant la Seconde Guerre Mondiale et avait fait la Guerre d’Indochine. Cela l’avait plongé dans une grande solitude et dans une réelle détresse, particulièrement lorsqu’il voyait ses compagnons disparaître sous les feux de l’ennemi. Amrouche, lui, s’était acharné pour garder en vie la T.F.L. qui fut la première revue à prendre des positions tranchées contre le nazisme. Cet engagement ne plaisait pas au régime français qui voulait interdire la publication du titre. Plus tard et juste après les événements du 8 mai 1945 en Algérie, Jean Amrouche avait choisi son camp : l’indépendance algérienne : « J’ai peur que la blessure creusée au corps et au cœur d’un peuple demeure longtemps suppurante[7]. » Et Jules Roy de lui répondre : « … une grande tristesse me gagne p.c.q. nous avons fait une guerre de cinq ans pour en arriver à ce mépris de l’homme[8]. »
La sensibilité des deux hommes à l’évolution de l’Histoire se manifeste aussi pendant la Guerre d’Algérie. Amrouche, qui fut à l’origine de la rencontre en 1959 du général de Gaulle avec le président du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), Ferhat Abbas, avait compris que sa mission était d’être le porte-voix de sa patrie dont il vivait toutes les souffrances au point de se sentir étranger dans le pays qu’il s’était inventé : « Tu n’imagines pas combien je me sens seul, enfoui dans mes problèmes, prisonnier de mon “intelligence”, séparé de tous, saignant avec mes frères de sang, repoussé par une force irréductible loin de ceux que je côtoie tous les jours, dont les livres me parlent un langage étranger…[9] ». Jules Roy était également affecté par cette guerre et le dit : « J’ai honte d’être français. Je ne veux plus être solidaire de la connerie de mes compatriotes[10]. » Et Jean Amrouche, dont l’attachement à la civilisation française était pourtant sans faille, d’ajouter : « Quant à l’Afrique du Nord, écoute-moi bien, qui pèse mes mots, j’en suis venu à croire qu’elle ne trouvera son être, si elle le trouve jamais, que contre la France[11]. »
La Guerre d’Algérie a réveillé d’autres blessures, identitaires celles-là. Jean Amrouche, dont Charles de Gaulle même voulait faire le « Jean Moulin algérien », était considéré par ses proches comme un Français. Mais les différends professionnels et la Guerre d’Algérie ramenaient le « Bougnoule », comme il se présentait avec provocation, à une autre réalité : « Les hommes de mon espèce sont des monstres, des erreurs de l’histoire[12]. » Ce conflit identitaire peut expliquer l’intransigeance d’Amrouche qu’on ressent notamment dans les entretiens littéraires, dont il est le créateur, à la R.T.F. (Radiodiffusion-télévision française) où il aimait imposer jusqu’à un certain point sa propre conception de la littérature. Cette intransigeance est redoublée par son statut particulier dans le monde. Connu et admiré des plus grands, il est oublié du public populaire car il n’a produit que deux recueils de poésie et une traduction contrairement à ses amis, dont Jules Roy, qui se sont fait une situation dans l’univers littéraire.
La correspondance Jean Amrouche-Jules Roy est hantée par les morts. Plus que la disparition de la mère de Jules Roy, c’est celle de Saint-Exupéry qui revient dans une partie des lettres échangées : « … il était vraiment l’homme du XXe siècle dans sa plénitude accomplie, il était la mesure de l’homme[13]. » Quelques mois après la mort d’Albert Camus, Jean Amrouche qui s’en alla à son tour. Suzanne, sa femme, avait trouvé en Jules Roy un fidèle ami et un solide soutien. C’est à lui qu’elle demanda conseil quand il fut question de créer « un “club” ou un “groupement des amis de Jean Amrouche”[14] » que Jean Daniel devait intégrer et qui devait être présidé par le chef de l'Exécutif provisoire algérien à l’indépendance du pays, Abderrahmane Farès.
D’une amitié découvre la relation d’une intimité et d’une pudeur rarissimes entre deux poètes majeurs du XXe siècle. Deux « absents » extrêmement et infailliblement présents l’un pour l’autre. Cette correspondance illustre cette capacité qu’avaient Amrouche et Roy à tout exprimer de l’âme humaine, même ce qui peut nous paraître ineffable. Loin des figures publiques, nous faisons la connaissance de deux vies, voire d’une vie privée. Cela rehausse encore davantage les rebelles et les confirme dans leur immortalité qui explique le « Prélude à l’Immémorial[15] » qui ouvre cette correspondance et dont l’auteur n’est autre que Jules Roy qui conclut une de ses lettres : « À toi, Jugurtha, le salut de Genséric[16]. »
[1] D’une amitié. « Correspondance. Jean Amrouche-Jules Roy (1937-1962) », Aix-en-Provence, Édisud, 1985.
[2] Lettre « [XXXVII. Jean Amrouche à Jules Roy », op. cit., p. 60.
[3] Lettre « [LXII. Jean Amrouche à Jules Roy », op. cit., p. 89.
[4] Lettre « LIV. Jean Amrouche à Jules Roy », op. cit., p. 78.
[5] Lettre « LIX. Jules Roy à Jean Amrouche », op. cit., p. 85.
[6] Ibid.
[7] Lettre « XLII. Jean Amrouche à Jules Roy », op. cit., p. 65.
[8]Lettre « [XLIV]. Jules Roy à Jean Amrouche », op. cit., p. 67.
[9] Lettre « LXXII. Jean Amrouche à Jules Roy », op. cit., p. 97.
[10] Lettre « LXXX. Jules Roy à Jean Amrouche », op. cit., p. 104.
[11] Lettre « LXXII. Jean Amrouche à Jules Roy », op. cit., 98.
[12] Lettre « LXXIX. Jean Amrouche à Jules Roy », op. cit., p. 104.
[13] Lettre « XL. Jean Amrouche à Jules Roy », op. cit., p. 69.
[14] Lettre « LXXXIII. Rémy Renou à Jules Roy », op. cit., p. 107.
[15] Op. cit., p. 11.
[16] Lettre « LV. Jules Roy à Jean Amrouche. », op. cit., p. 81.
commenter cet article …




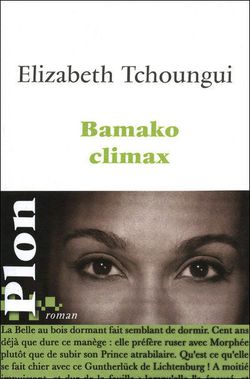
 Dans Demain j’aurai vingt ans
Dans Demain j’aurai vingt ans




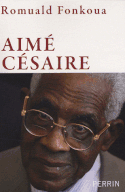 Depuis le décès d’Aimé Césaire en avril 2008, les intellectuels du monde francophone ont consacré des ouvrages au grand poète martiniquais, geste qui leur permet de lui vouer un hommage. Tel est le cas de Romuald Fonkoua, professeur à l’université de Strasbourg, spécialiste des littératures et cultures de l’Afrique subsaharienne et des Antilles, qui a publié récemment une biographie d’Aimé Césaire aux Editions Perrin. Ce vaste et riche travail sur la vie de cette figure tutélaire de la francophonie met en relief la complexité du parcours de Césaire en tant que poète et homme politique.
Depuis le décès d’Aimé Césaire en avril 2008, les intellectuels du monde francophone ont consacré des ouvrages au grand poète martiniquais, geste qui leur permet de lui vouer un hommage. Tel est le cas de Romuald Fonkoua, professeur à l’université de Strasbourg, spécialiste des littératures et cultures de l’Afrique subsaharienne et des Antilles, qui a publié récemment une biographie d’Aimé Césaire aux Editions Perrin. Ce vaste et riche travail sur la vie de cette figure tutélaire de la francophonie met en relief la complexité du parcours de Césaire en tant que poète et homme politique.
 David Alliot,
David Alliot,