Récit de vie d’un dictateur condamné
Par Ali Chibani
Si l’on devait distribuer un livre aux peuples actuellement en révolte contre les dictatures de la rive sud de la Méditerranée, Une paix à vivre, de l’écrivain algérien Rachid Mimouni, serait tout indiqué tant il décrit avec réalisme et déconstruit avec lucidité les mécanismes de domination et de perpétuation de ces régimes.
Tout le long de ce récit, on entend la voix d’un condamné à mort. Celui-ci est dos au « polygone » des fusillés. Dans ce court instant, ce hiatus dans le récit principal, qui le sépare de l’application de sa peine, il se souvient de l’histoire de sa vie jusqu’à ce moment fatidique dans un monologue intérieur qui, écrit, devient un manuel pour dictateurs. Le condamné était « Maréchalissime ». Mimouni nomme ainsi tous les militaires qui prennent le pouvoir par des coups d’Etat, règnent sans partage pendant des années où ils ne pensent qu’à perpétuer leur autorité pour préserver leurs avantages en semant la mort et le désarroi, avant d’être renversés chacun leur tour par d’autres militaires qu’ils auront eux-mêmes aidés à entrer dans le cercle fermé de la société du Palais. Plus précisément, « Maréchalissime » est le titre que ces chefs du Palais se lèguent l’un à l’autre comme ils se laissent en héritage une seule et même politique faite de corruption et de prédation, d’enlèvements et de meurtres. Pour mettre en exergue cet état de fait, Rachid Mimouni a choisi de priver de noms tous les personnages de son œuvre. Aucun d’eux n’est nommé. Ils ont tous un titre de fonction qui reflète leur rôle et leur position au Palais ou au sein de l’armée. Cet anonymat renforce le sentiment d’inanité et d’immobilisme qui caractérise ces régimes de cautèle(s). Le parcours du Maréchalissime-narrateur n’est donc que le parcours exemplaire de tous ceux qui l’ont précédé et de tous ceux qui vont lui succéder. Il s’applique aussi bien à l’Algérie, qu’à la Tunisie ou à l’Egypte.
Une enfance « calamiteuse »
Le narrateur commence par raconter « sa calamiteuse enfance d’orphelin » (p. 24). Abandonné par sa tribu après que ses parents ont été emportés par une rivière en crue, adopté par un « parent à la froideur marmoréenne » (p. 19), il va travailler dans un champ de tabac. L’odeur et la couleur de cette plante qui lui collent à la peau le rendent complètement malade tant sur le plan physique que psychique. Il va donc s’employer toute sa vie à lutter contre le tabac de son enfance et à étouffer de cette « peine », les « feuilles de tabac » étant une métaphore qui pourrait désigner à la fois le complexe d’infériorité résultant de son enfance difficile et l’idée noire du pouvoir. Si le « pouvoir » attire tout être humain qui désire, d’une manière ou d’une autre, affirmer son autorité dans le monde, il est des personnes chez qui ce désir d’autorité semble maladif au point de dominer toute leur vie :
Durant plusieurs semaines, j’eus à disposer feuille après feuille sur la saignée du bras. Non, ce n’était pas un travail de forçat. Mais le rugueux parenchyme enduisait peu à peu de résine noire la peau des mains, des avant-bras, de la poitrine, du cou puis du buste tout entier. Et surtout, surtout, cette molle gomme imprégnait mon être d’une écœurante odeur. J’en eus des nausées à vomir toutes mes entrailles, des toux qui déchiraient mes poumons. (p. 79).
Ce qui motive le personnage locuteur à tout sacrifier pour prendre le pouvoir, c’est un désir de vengeance et de revanche :
Auparavant, jamais, au grand jamais je n’étais parvenu à me débarrasser de ce complexe originel qui pesait si fort sur mes épaules que je ne voyais le monde que l’échine courbée. Je ne pouvais concevoir d’établir un rapport d’égalité avec autrui. Je restais toujours l’inférieur. Le fils de bohémiens que j’étais n’avait jamais pu envisager de regarder les autres de la même hauteur. Si je m’étais inconsciemment dirigé vers la carrière militaire, c’est que j’avais senti que l’uniforme allait me conférer ce surcroît de taille qui me manquait. […] J’eus enfin l’audace de fixer le soleil. La première étoile qui vint orner mon épaulette fit gonfler ma poitrine. Je me sentais grandir et épaissir à mesure que mes épaules se chargeaient d’insignes dorés. (p. 219).
L’Etat est l’endroit où le narrateur peut réaliser toutes ses ambitions en la matière puisque l’Etat est l’outil grandiose de la vengeance. Chez ce personnage, l’obsession est liée à un manque de reconnaissance qui est survenu à un âge précoce. Dès son enfance, il est victime d’une hémorragie narcissique et d’une forme de mutilation physique qui devient rapidement ontologique. La gomme du tabac recouvre la peau du personnage comme elle recouvre son humanité pour ne laisser transparaître qu’un être mystérieux et malfaisant, qui va étouffer le monde comme les travaux dans les champs de tabac l’ont étouffé.
L’itinéraire d’un dictateur
L’histoire du Maréchalissime principal dans Une peine à vivre est celle d’une lente mais sûre ascension vers le sommet de l’Etat. L’orphelin, petit voleur puis travailleur dans les champs de tabac entre dans l’armée à seize ans. Analphabète, fragilisé par une adolescence difficile, il gagne le respect des anciens en poignardant le plus autoritaire d’entre eux qui voulait le violer. Après avoir accompli les basses tâches dans la caserne, il gagne ses galons d’adjudant-chef. Il réussit, en menant dans le lit de son sergent la femme d’un honnête avocat, à se faire admettre à l’Académie Militaire, où sont formés, pour ainsi dire, les « énarques » des régimes militaires. Même s’il n’arrive pas à surmonter son illettrisme, le futur Maréchalissime réussit tous ses examens. En effet, il fait chanter le lieutenant responsable des dossiers des élèves de l’école pour qui il vient de récolter des informations sur les autres élèves, tout en profitant de cette opportunité pour découvrir des nouvelles compromettantes sur lui : « Tu dois me procurer les sujets des examens. Comme tu le feras aussi l’année prochaine et les deux qui suivront. Après cela, tu oublieras les anomalies de mon dossier comme j’effacerai de ma mémoire tout ce qui te concerne. » (p. 57). Fort de son succès immérité aux examens de l’Académie, il est affecté à l’état-major général où il fait un premier constat sur l’oisiveté du personnel :
Je devais me rendre compte que nous étions ainsi des centaines, éloignés du lieu essentiel, à errer sous surveillance le long d’interminables couloirs, discrets ou cabotins, silencieux ou prolixes, choyés mais oisifs, sans fonction ni pouvoir réels. […] Les plus blasés s’occupaient tranquillement de la construction de leur villa, de la scolarité de leurs enfants à l’étranger, de l’aménagement de l’appartement de leur dernière maîtresse ou de la quantité des derniers produits importés par les coopératives spéciales de l’armée. Il n’en restait que quelques-uns qui, comme moi, sans cynisme désabusé ni excessive jobardise, se contentaient d’attendre en expédiant les petites tâches qu’on voulait bien leur attribuer. (p. 63).
Pour atteindre le « lieu essentiel », le jeune militaire devient « l’homme à tout faire de l’officier » supérieur. Celui-ci est aussi pris au piège de l’ambitieux personnage qui le menace de le jeter en pâture sur la scène publique en dévoilant ses mœurs scandaleuses, à moins de lui confier des missions plus rehaussantes. Ce qui est fait rapidement pour l’engager à devenir l’espion envoyé dans les réunions du Parti central où « [l]e présentateur présentait, l’orateur parlait, les assistants applaudissaient, puis tout le monde se dispersait. » (p. 65). C’est ensuite à « la faune diplomatique » (p. 70) d’être traversée par l’œil scrutateur de l’agent militaire qui y découvre un monde fait de compromissions avec les dictateurs, de faux-semblants et où tout se gagne et se donne sur le dos des femmes. Le narrateur réussit ensuite à faire son entrée au Palais et devient responsable de la Sécurité d’Etat, un poste qu’il occupe malgré les risques encourus. Celui dont il veut prendre la place au sommet du pouvoir le prévient sans craindre la contradiction : « Que tu me serves mal ou trop bien, que je prenne ombrage de ta puissance ou que je sois excédé par tes bourdes, et tu aboutiras au polygone. » (p. 85). Et le même d’ajouter : « Tu seras alors étonné de découvrir que la servilité humaine n’a pas de limite et que la dignité n’est qu’un mot creux. » (p. 85). Après une période passée au service du Maréchalissime, le personnage-narrateur, qui a retrouvé son compagnon des champs de tabac, orchestre un coup d’Etat et prend le pouvoir les pieds pataugeant dans le sang. Il découvre alors que son ascension au Palais a été voulue et habilement orchestrée par sa « victime ».
L’amour : rétablissement du lien défectueux et l’Autre comme miroir
À travers le personnage principal, Rachid Mimouni expose l’itinéraire des militaires à la tête de l’Etat algérien parallèlement à un itinéraire littéraire qui réduit les généraux, qui impressionnent tout un peuple, à leur stature minable de calculateurs mégalomaniaques que la paranoïa pousse à commettre des crimes gratuits. L’itinéraire littéraire est parsemé d’hyperboles et d’épithètes péjoratives. La figure de la répétition reste la première caractéristique du récit puisqu’il s’agit de divulguer un mécanisme de domination inlassablement réitéré par les militaires.
Cependant, l’auteur fait vivre à son personnage une parenthèse – hiatus dans le hiatus – qui le coupe des intrigues du Palais. Quand le premier Maréchalissime lui fait part de sa volonté de le nommer à la tête de la Sécurité d’Etat, le narrateur demande un temps de réflexion qu’il va passer dans un hôtel situé dans un lieu perdu du monde. Dans cet hôtel, il rencontre une jeune étudiante qui va lui faire découvrir l’amour et la vie. Ce personnage apprend que la femme ne se réduit pas à un objet sexuel que les pères, les frères ou les fils en mal de promotions offrent aux personnages haut-placés afin de les amadouer. Mais cette idylle est contraire au code de conduite des militaires comme le montrent les propos du premier Maréchalissime : « Un conseil cependant : ne te laisse mener par aucune passion, c’est dangereux. » (p. 85).
Le personnage narrateur vivra toute sa vie dans le questionnement : cette fille est-elle réellement une étudiante en architecture comme elle le prétendait où un agent au service du Palais envoyé pour lui faire prendre du bon temps et lui soutirer des informations sur son enfance dont il n’a jamais rien révélé à ses collaborateurs ? Après avoir pris le pouvoir, assuré ses arrières en éliminant ou en emprisonnant tous ses opposants et tous ceux qu’il juge dangereux et susceptibles de convoiter sa place, le Maréchalissime narrateur refuse toutes les femmes que lui propose la gouvernante du Palais. Le souvenir de son idylle le hante et il décide de retrouver la jeune fille mystérieuse en employant les grands moyens. Il mobilise toute la Sécurité d’Etat et la Contre-Sécurité d’Etat pour qu’elles passent au peigne fin tout le territoire national. Elle est finalement retrouvée à Paris et enlevée par un mercenaire qui est immédiatement exécuté par les agents de la Sécurité d’Etat. L’affaire, divulguée par la presse étrangère, est vite étouffée après que le Maréchalissime s’est engagé à signer tous les contrats pétroliers en attente avec les entreprises du « pays ami ».
Pour séduire la jeune femme qui refuse de le voir, le Maréchalissime lui promet monts et merveilles : il plante des fleurs dans le Palais, il amène toute sorte d’oiseaux car son aimée apprécie leur chant, il décide de la création d’un orchestre national pour qu’elle écoute la radio nationale et non plus la musique diffusée sur les ondes étrangères… Bref, on assiste à un retour à/de la culture et du Beau comme formes de contre-pouvoir effectif. Il faut dire que la jeune fille est quasiment le seul personnage à se positionner dans l’altérité par rapport au Maréchalissime. Elle refuse de se soumettre à son autorité et la flagornerie n’est pas sa spécialité. Par ce positionnement, elle amène son ancien amant à être face à lui-même, notamment grâce à son journal intime – cette parole dans la parole qui donne un autre visage au succès du militaire – que le Maréchalissime fait voler pour le lire. Il se découvre en dictateur qui fait honte à son peuple. Celui qui « … n’avai[t] guère de goût pour l’introspection… » (p. 87) est contraint à faire son examen de conscience : « Je me suis contenté d’appliquer les préceptes de mon prédécesseur afin de faire partout régner la terreur. J’ai passé mon temps à dégrader ou assassiner tous ceux qui me menaçaient ou me déplaisaient. J’ai gouverné selon mon plaisir, c’est-à-dire sans remords et sans miséricorde » (p. 246). Une nouvelle fois, la peau narcissique du personnage se déchire. Celui-ci va alors tout mettre en œuvre pour la réparer mais sans aucune sincérité. C’est ce que dénote ce discours qui n’est pas sans nous faire penser aux stratégies employées par Zine El Abidine Ben Ali, Hosni Moubarak et Abdelaziz Bouteflika pour duper leurs populations et prolonger la durée de leur présence à la tête de l’Etat : « Grâce à elle, j’ai pris conscience de la nécessité d’améliorer mon image de marque. […] Ne crois-tu pas qu’il est temps pour nous d’élaborer une constitution qui serait soumise au peuple et par conséquent approuvée à une écrasante majorité ? » (p. 237). Cette prise de conscience l’a déjà amené à « procéder à un remaniement ministériel gouvernemental, afin de marquer le début d’une nouvelle ère. » (p. 201). Quelques pages plus loin, nous pouvons lire cette mise en emphase de la répétition comme moyen d’envoûtement de la population et le renouvellement du discours comme opération magique destinée à duper les médias internationaux :
Il faut que tu saches que tout est dans le verbe et l’incantation. Il suffit de réaffirmer impudemment et indéfiniment les choses, et elles finissent par pénétrer les caboches les mieux blindées. […] Je veux que la presse internationale se fasse l’écho de toutes nos belles décisions. Nous allons supprimer la Cour de sûreté de l’État, instituer l’indépendance de la justice, instaurer la liberté de la presse, abolir la limitation de vitesse sur les autoroutes, bannir la torture et les sévices corporels, interdire aux flics d’arrêter ceux qui portent des moustaches semblables aux miennes sous inculpation de faux et usage de faux, punir les auteurs de malversations, même s’ils appartiennent à ton cabinet, pénaliser tous les contrevenants, acquitter les innocents, quel que soit l’outrage commis. Tu commenceras par le claironner bien haut avant de l’appliquer prudemment. (p. 241).
L’antithèse qui caractérise la conclusion de ce passage (« claironner bien haut », « appliquer prudemment ») prouve que le Maréchalissime orchestre tout avec doigté et application. Mais cela ne suffit pas pour séduire la jeune étudiante prisonnière du Palais. Conséquemment, le Maréchalissime, qui va jusqu’à exiger du directeur des services météorologiques de faire apparaître le soleil alors qu’il fait un temps hivernal, se soumet au sentiment amoureux qui motive ses nouvelles décisions. La fille, comme le soleil qu’il ne peut pas forcer à se montrer, est le rempart contre lequel vient s’écraser sa toute-puissance. Les rapports s’inversent alors et le Maréchalissime n’est plus le dépositaire d’une quelconque autorité mais un être soumis. Lui qui avait l’habitude de gérer jusqu’au quotidien des individus propose à son aimée de faire de son quotidien ce qu’elle veut :
Je lui avais promis qu’elle pourrait régenter le Palais à sa guise, décider de tout, régir le personnel, ordonner ou annuler les réceptions, changer les dates des fêtes légales et la couleur des draps de toutes les chambres, renouveler l’ameublement, choisir mes costumes, définir la longueur idéale des poils de ma moustache, corriger les recettes du cuisinier et même m’interdire de pisser chaque matin sur le rosier qui ornait le perron. (p. 211-212).
Pour le Maréchalissime, s’il faut choisir entre le pouvoir et l’amour, il faut choisir l’amour. Il regrette alors sa position et découvre que son autorité n’est qu’illusion, que ceux qui subissent sa colère ont le pouvoir qui lui échappe, celui d’être heureux : « Justement, à quoi me sert d’être Maréchalissime si je ne peux influer sur ce qui m’importe le plus ? Un paysan aimé de sa femme est plus heureux que moi. » (p. 218).
Ultime décision, le Maréchalissime démissionne de son poste. C’est l’acte qui lui est fatal et lui coûte la vie. En effet, son compagnon des champs de tabac est mandaté par les généraux pour prendre d’assaut le Palais et occuper sa place les protégeant ainsi des mains de la justice. Les vengeurs qu’ils sont redoutent en premier lieu la vengeance de leurs peuples. Alors que l’Histoire se répète, que les soldats font feu sur lui, le personnage narrateur et ex-Maréchalissime goûte à la victoire d’avoir rétabli le lien social suprême qu’est l’amour puisque, au moment de s’effondrer, il voit la personne aimée courir vers lui.






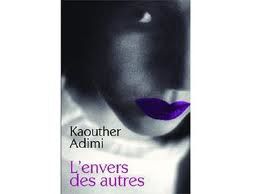
 C’est une poésie fulgurante, entraînante par son rythme révolté et exaltante par l’espoir qui la porte et qu’elle transmet, que Jean-Pierre Orban a rééditée dans sa collection « L’Afrique au cœur des lettres » chez l’Harmattan. Lire la suite
C’est une poésie fulgurante, entraînante par son rythme révolté et exaltante par l’espoir qui la porte et qu’elle transmet, que Jean-Pierre Orban a rééditée dans sa collection « L’Afrique au cœur des lettres » chez l’Harmattan. Lire la suite 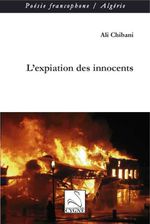 Il est toujours difficile de parler de poésie, doit-on se réduire à parler « sur », quitte à dénaturer ? Parler de poésie, une gageure… sous forme de défi à relever au nom de l’amitié mais aussi et surtout de l’admiration. La Plume Francophone a en effet de quoi se réjouir aujourd’hui en comptant parmi ses fondateurs et rédacteurs un poète, Ali Chibani, qui a publié cette année son premier recueil, aux Éditions du Cygne, L’expiation des Innocents
Il est toujours difficile de parler de poésie, doit-on se réduire à parler « sur », quitte à dénaturer ? Parler de poésie, une gageure… sous forme de défi à relever au nom de l’amitié mais aussi et surtout de l’admiration. La Plume Francophone a en effet de quoi se réjouir aujourd’hui en comptant parmi ses fondateurs et rédacteurs un poète, Ali Chibani, qui a publié cette année son premier recueil, aux Éditions du Cygne, L’expiation des Innocents